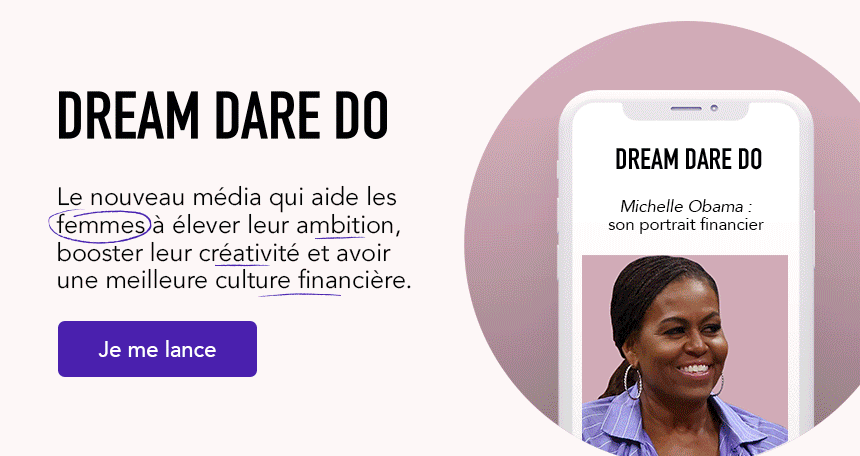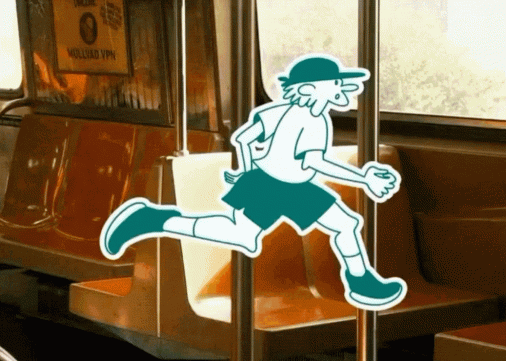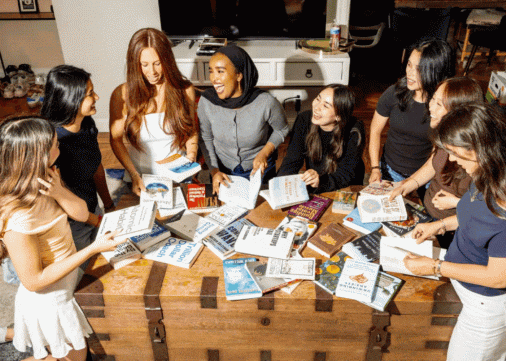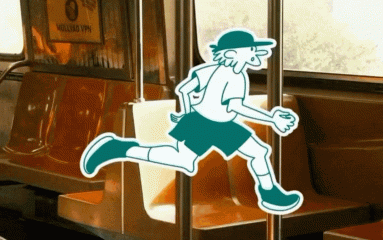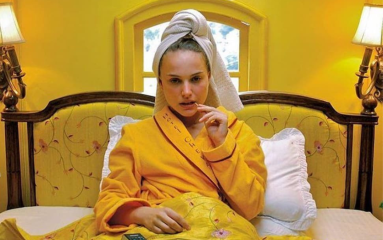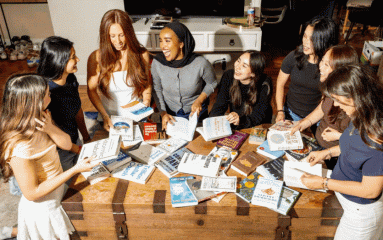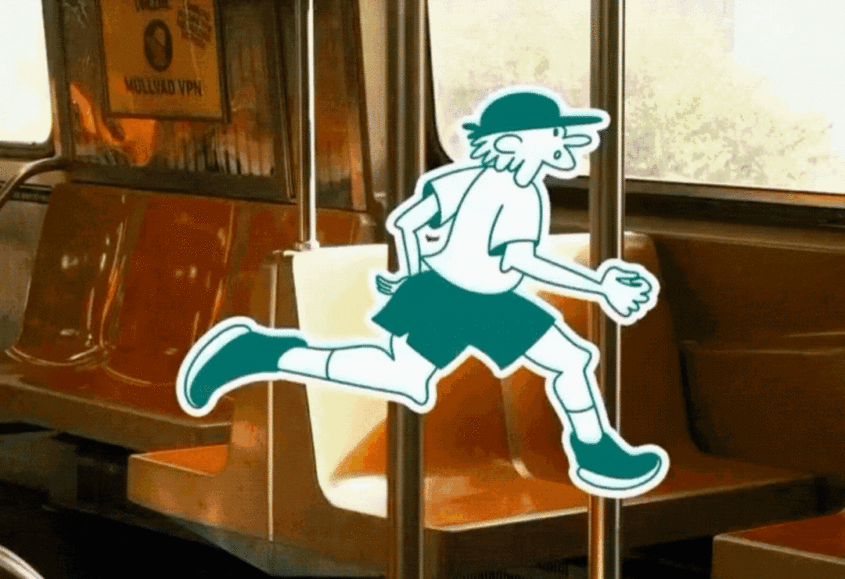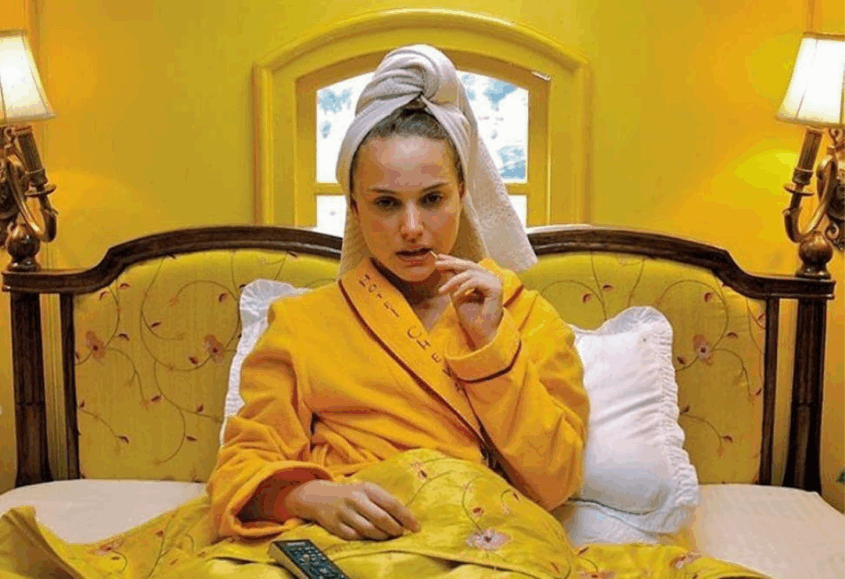Crédit : Eva Bee/The Observer
Ça vous est déjà arrivé de prendre votre temps, tout votre temps, pour faire un simple créneau dans une rue bondée, sachant pertinemment que vous bloquiez la circulation ? Ou d’arroser vos plantes pile au moment où une famille nombreuse en pleine promenade passe tranquillement sous vos fenêtres ? Ou d’arracher son jouet à un enfant, sans aucune raison valable, just because I can ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas une mauvaise personne. Selon Simon McCarthy-Jones, professeur associé en psychologie clinique et en neuropsychologie au Trinity College de Dublin, vous pourriez-même être un poil plus au fait que le reste du monde sur la façon dont on peut exploiter le spectre entier de nos émotions, comme il l’explique dans son livre Spite : The upside of your dark side(Oneworld Publications) Alors certes, pour l’être humain lambda, il semble illogique et peu productif d’embrasser avec enthousiasme une attitude volontairement blessante, pour l’autre comme pour nous. Car à priori, faire preuve de méchanceté est aussi pesant pour les autres que pour soi-même, en ce que cela crée un fossé entre les personnes, abîme notre confiance en les relations humaines et laisse dans la gorge un arrière-goût de culpabilité qui peut traîner longtemps (cf ces nuits d’insomnies passées à ressasser cette réflexion humiliante qu’on a gratuitement faite à quelqu’un il y a huit ans). McCarthy-Jones l’affirme pourtant : la méchanceté, cette épée de Damoclès qui pend au-dessus de nos interactions sociales (ou du moins ce qu’il en reste), « a rendu la société plus juste et plus coopérative. » Mais comment, au juste ? 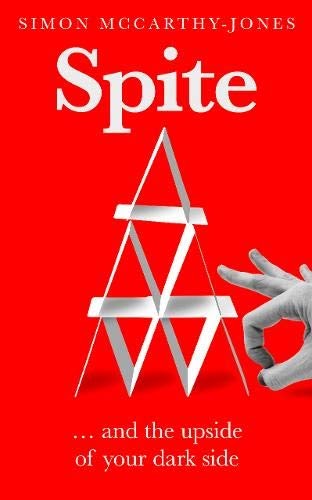
C’est pas moi, c’est les gènes
Et déjà, elle vient d’où, cette méchanceté ? Existe-t-il un gène de la malveillance, distribué arbitrairement toutes les quelques naissances et qui stagne comme une mauvaise herbe dans un coin de notre cerveau, prête à dégainer un « T’es moche » ou à faire un croche-patte à une personne âgée ? Pas exactement. Pour David Marcus, professeur de psychologie à l’Université de Washington, il est en effet peu probable qu’un tel gène existe, il affirme en revanche l’existence de « traits de personnalité fondamentaux avec une charge génétique élevée », et cite en exemple l’antagonisme – ou le fait d’aller volontairement à l’encontre des autres – et l’absence d’empathie, facteurs clés de la méchanceté, mais aussi du sadisme ou de la psychopathie. Le degré de méchanceté de chacun relèverait en fait de cette fameuse histoire d’équilibre entre l’inné et l’acquis, et atteindrait son pic vers la fin de l’adolescence, particulièrement chez les hommes (hop, ça c’est gratuit). Selon Rory Smead, professeur associé en philosophie à l’Université du Nord-est du Massachusetts, Internet a facilité l’anonymat et, avec, fait prospérer une forme de méchanceté caractéristique de notre époque et incarnée par les trolls, qui règnent en sadiques sur l’étrange et infini royaume des commentaires Youtube (et taclent avec la même violence Dora l’exploratrice et Emmanuel Macron). Le principe est simple : si je peux m’en sortir sans que personne ne sache que c’était moi, les conséquences sur ma personne seront relativement minimes, et mon besoin de cruauté inné satisfait. Autrement dit, le pendant digital de notre monde offre le terrain parfait pour relâcher ses nerfs sans s’encombrer du risque d’en payer les conséquences. Pas vu, pas pris. Plus encore, en se faisant par exemple chambres d’écho de débats politiques houleux entre conservateurs et progressistes, Internet et les réseaux sociaux ont fait de la méchanceté une arme de victoire redoutable. Se montrer volontairement critique, moqueur ou humiliant face à l’opposition a désormais autant de poids que de proposer des actions concrètes, un principe dont les Trump ont allègrement fait leur beurre. Simon McCarthy-Jones rappelle d’ailleurs que de nombreux Américains ont voté Trump en 2016 non pas par conviction, mais pour « punir » une Hillary Clinton trop présomptueuse. Idem pour le Brexit : selon lui, bon nombre de Leavers étaient plus motivés par l’envie de coller les boules à l’Union européenne que par la conviction d’une relance économique. 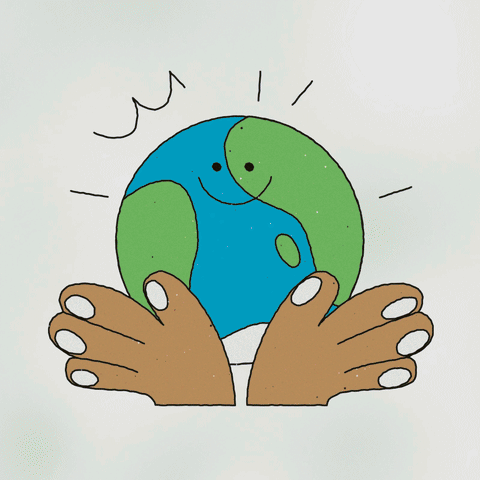
Un mal pour un bien
Alors c’est bien beau tout ça, mais quelles sont-elles, les conséquences positives de la méchanceté ? En quoi taper sur le voisin nous rendrait-il plus justes et coopératifs ? Pour David Marcus, c’est à une échelle sociétale que s’expriment ces bienfaits. Il cite l’exemple d’un collègue professeur qui, fatigué de voir ses étudiants garés n’importe comment, aurait créé un faux carnet d’amendes pour les punir un à un. Une action un poil sadique et dont l’homme n’a tiré aucun bénéfice personnel, mais qui a permis d’obtenir le respect des règles de stationnement, facilitant la vie à tous les usagers du parking. Il évoque également les mouvements sociaux de grande ampleur, et prend l’exemple des manifestations en Biélorussie. « Une des quelques possibilités qu’a le régime de changer est que les travailleurs se préparent à la grève, et payent un coût personnel pour nuire économiquement au régime de Loukachenko. » assure-t-il. Un effondrement forcé et volontaire de l’économie pourrait, en aval de ses conséquences immédiates, ouvrir la voie à la transition vers un régime politique sain et rétablir l’équilibre dominant-dominé.Des scientifiques se sont penchés sur la théorie des jeux, notamment celui de l’ultimatum, utilisé en économie expérimentale : un joueur 1 reçoit une somme d’argent, qu’il peut partager comme il l’entend avec un joueur 2, sachant que si ce dernier rejette l’offre, aucun des deux n’obtient l’argent. Si la somme offerte au joueur 2 est faible, il la refusera, vexé de ce manque d’équité, et privera les deux parties de récompenses. Ainsi, le joueur 1 aura tendance à diviser la somme équitablement, par peur de faire face à la rancune du second. Aussi désarmant que ça soit, la peur du mal reste manifestement un moteur efficace pour faire le bien. Notons tout de même que l’altruisme reste probablement la meilleure façon d’opérer, à échelle humaine comme sociétale. Mais dans un monde de plus en plus polarisé, dialogue, écoute, humilité et ouverture ne tiennent pas toujours du réflexe instinctif. Alors être méchant, c’est ok, mais seulement pour peu qu’on soit motivé par autre chose que le pur plaisir de nuire.